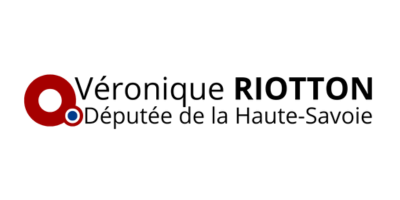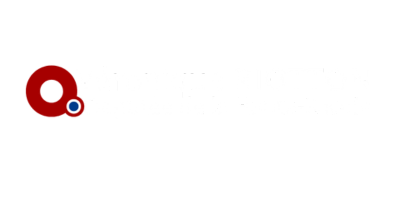Intégrer le consentement dans la définition pénale du viol
"Passer de la culture du viol à la culture du consentement".
Aujourd’hui, le viol est défini dans notre code pénal non pas par l’absence de consentement, mais par des moyens – violence, contrainte, menace ou surprise – qui invisibilisent la réalité de nombreuses victimes de viol. Dans 90% des cas, l’agresseur est un proche de la victime. Ce crime de l’intime entraîne dans près de 7 cas sur 10 un état de sidération ou de choc chez la victime, qui peut se voir refuser la reconnaissance de l’agression faute de « résistance ».
Le silence du code pénal sur le consentement entraîne une inégalité d’accès à la justice : l’absence de réaction de la victime est perçue comme un accord à l’acte sexuel, et la jurisprudence n’est pas toujours correctement mobilisée. Cette situation alimente une culture du viol qui banalise les violences sexuelles et décourage les plaintes.
Le viol constitue le crime le plus sous-déclaré aux autorités aujourd’hui en France, avec près de deux tiers des victimes qui ne passent pas la porte d’un commissariat.
Quatorze mois de travaux, près de 100 auditions
En décembre 2023, j’ai été nommée, aux côtés de Marie-Charlotte Garin (députée Les Écologistes), co-rapporteure d’une mission d’évaluation parlementaire chargée de répondre à la question faut-il inscrire la notion de consentement dans la définition pénale du viol ?
Pendant quatorze mois, nous avons conduit près de 100 auditions — victimes, magistrats, avocats, associations, experts — pour comprendre les failles du système actuel et construire une réponse à la hauteur de l’enjeu.
Comprendre la notion de consentement
Notre proposition de loi (PPL)
La proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles vient réparer un vide juridique, renforcer la protection des victimes, et aligner notre droit avec les principes fondamentaux du respect de la dignité humaine, et de l'intégrité physique et psychique des individus.
Elle est le fruit d'un travail parlementaire exigeant et transpartisan, et s'appuie sur :
- Les jurisprudences françaises récentes
- Les législations des pays voisins
- Et surtout, un avis favorable du Conseil d'État qui garantit sa solidité juridique
Quels objectifs ?
Harmoniser la jurisprudence pour toutes les victimes et garantir leur égalité devant la loi
La jurisprudence n’est pas appliquée par tous les juges de façon homogène, et progresse trop lentement pour permettre l’égalité des victimes devant la loi. En introduisant le consentement et ses modalités d’expression dans le code pénal, tous les cas possibles et le meilleur de la jurisprudence sont inscrits explicitement dans la loi.
Inscrire dans le marbre de la loi une définition pénale du viol en adéquation avec la réalité des victimes
Le viol est un crime de l’intime, commis par des individus souvent connus et proches des victimes. Elles sont dans l’écrasante majorité des cas dans l’incapacité de refuser, se débattre, ou fuir. Il est donc attendu de la victime qu’elle réagisse pour caractériser le viol, ce qui reproduit une vision stéréotypée et divergente de la majorité des cas de viol aujourd’hui. Clarifier la définition autour du consentement permet aux victimes de se reconnaître davantage, et d’être encouragées à porter plainte.
Mieux outiller les juges pour mieux caractériser le crime de viol
Tout en laissant aux juges leur droit d’interprétation, le changement de définition proposée vient centrer les investigations sur les agissements de l’auteur. Cette définition permet de regarder au-delà des quatre critères de définition actuels à l’aune du non-consentement de la victime, ce qui ouvre un champ de preuves plus larges pour les enquêteurs et les juges.
Passer de la culture du viol à la culture du consentement
Cette modification du code pénal marque un changement de paradigme fort pour l’institution judiciaire et acte que nous passons collectivement de la culture du viol à la culture du consentement.
Ce que change la loi :
Le parcours de la loi
21.01.2025
Dépôt de la proposition de loi à l'Assemblée nationale
11.03.2025
Avis favorable du Conseil d'État
26.03.2025
Adoption de la PPL en Commission des Lois de l'Assemblée nationale
1.04.2025
Adoption de la PPL à l'Assemblée nationale (1ère lecture)
2.04.2025
Adoption de la PPL en Commission des Lois du Sénat
18.06.2025
Adoption de la PPL au Sénat (1ère lecture)
Et maintenant ?
Pour répondre aux interrogations :
“Le consentement risque d’inverser la charge de la preuve, ou de mettre en danger la présomption d’innocence” :
Non, la charge de la preuve reste et restera au ministère public. Il ne s’agit pas d’une « présomption de non-consentement », mais d’un critère clarifiant la distinction entre rapport sexuel consenti et agression sexuelle. C’est l’objet de la preuve, et non la charge, qui change avec la définition proposée.
“Cela mettrait la victime au centre du procès ?”
Aujourd’hui les premières questions posées sont par exemple : A-t-elle crié ? résisté ? Dit non? Pourquoi est-elle restée ? Pourquoi est-elle revenue ? Ces interrogations sont devenues la norme dans la chaîne pénale. En introduisant l’absence de consentement comme élément constitutif de l’infraction, on demande justement au juge d’examiner ce qu’a fait l’auteur : s’est-il assuré du consentement de son ou sa partenaire ? A-t-il profité d’une situation de vulnérabilité ? A-t-il usé de pression,d’emprise ? Ce recentrage est essentiel : on juge les actes et l’intentionnalité de l’auteur, pas ceux de la victime. L’avis du conseil d’Etat est clair et explicite sur cette direction donnée aux magistrats et enquêteurs. Dans tous les pays qui ont changé leur législation pour introduire la notion de consentement, les victimes n’ont pas été mises au centre du procès, au contraire !
“La loi actuelle couvre déjà tous les cas de viol et d’agressions sexuelles”
Si la jurisprudence a élargi l’interprétation des critères actuels (violence, contrainte, menace, surprise), l’application reste inégale et dépend trop de l’appréciation des juges. La jurisprudence est fluctuante : par exemple, des jugements récents de la Cour de Cassation ne reconnaissent pas que l’ascendant d’un chef religieux sur une plaignante puisse constituer une forme de contrainte (le comportement passé de la victime est également utilisé comme défense de son consentement présumé), que l’absence de résistance physique disqualifie le viol subit par la plaignante, ou que le sommeil ne constitue pas la surprise si l’auteur s’est trompé sur la personne. L’introduction du consentement permettra d’uniformiser la réponse judiciaire (éviter l’effet “roulette russe” selon le juge et la jurisprudence mobilisée) et de garantir une meilleure protection aux victimes, en évitant que des victimes soient exclues de la reconnaissance du viol simplement parce qu’elles étaient sidérées et/ou ne pouvaient rentrer dans les quatre critères qui définissent exclusivement le viol aujourd’hui (violence, contrainte, menace ou surprise).
“Le consentement serait une notion floue et inadaptée au droit pénal”
La proposition de loi définit précisément le défaut de consentement : le consentement doit être donné librement, être spécifique, peut être retiré à tout moment (préalable et révocable), et ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de résistance· Le consentement est déjà utilisé en droit pénal pour d’autres infractions (exemples : interruption de grossesse sans consentement, atteinte à la vie privée). Le but est de recentrer l’attention sur l’auteur et non sur la victime, comme c’est majoritairement le cas dans les enquêtes aujourd’hui.
“Pas besoin de changer la loi, on peut faire une circulaire”
Le garde des sceaux peut faire une circulaire de politique pénale qui permet de donner des orientations pour mieux lutter contre certains faits. Mais il faut garder à l’esprit que les directives s’adressent aux parquets, qui sont sous l’autorité du garde des sceaux, mais pas aux magistrats du siège, qui sont indépendants ! En revanche, les magistrats du siège sont tenus d’appliquer la loi - il est donc plus protecteur pour les victimes de changer la loi que de passer par une simple circulaire.
“Le consentement est déjà pris en compte en pratique, ce n’est pas la loi mais la culture du viol qui pose problème”
Justement, en consacrant la notion de consentement dans la loi, on envoie un message fort pour déconstruire cette culture du viol au sein de la société et particulièrement dans l'Institution judiciaire, qui se manifeste par des classements sans suite non-justifiés massifs et des enquêtes centrées sur la crédibilité des victimes plutôt que sur les agissements des agresseurs.· Le Conseil d’Etat dans l’avis rendu sur la proposition de loi invite tous les acteurs et actrices de la chaîne judiciaire à rechercher en première intention si le consentement a été recherché et/ou recueilli par la personne mise en cause.
“La loi ne changera pas le traitement judiciaire des violences sexuelles”
L’introduction du consentement ne remplace pas les besoins en formation et en moyens pour la justice, mais elle les complète. C’est une avancée qui doit s’accompagner d’une meilleure formation des magistrats et des forces de l’ordre, et de moyens supplémentaires pour la justice. Au Danemark, en Belgique, en Suède, l’intégration de la notion de consentement dans la loi a eu un effet positif sur le nombre de dépôt de plaintes et le nombre de condamnations.